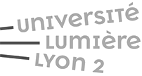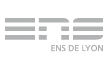Julia Chryssomalis

Chercheur.e.s, enseignant.e.s-chercheur.e.s - Université Lyon 2
Équipe Travail, Institutions, Professions et Organisations
- julia.chryssomalis@univ-lyon2.fr
- Lyon - Berthelot
Post-doctorante (22/04/2025-21/04/2027) rattachée à la Chaire Valeur(s) du soin, Fondation innovations et transitions, dans le cadre du Projet Solar-NAV (ANR-23-DMRO-0018).
Projet collaboratif intitulé « SOcial Logistics - Advanced Robotic NAVigation », porté par un consortium composé d’INRIA, Enchanted Tools, Station H (Living Lab d’innovation robotique des Hospices Civils de Lyon) et l’Université de Lyon.
Ce projet ANR 2030 vise à mener ensemble des travaux de recherche et développement. Il porte sur le développement, l’expérimentation et l’implémentation de robots sociaux en logistique hospitalière. À travers cette démarche, il est question d’explorer et de développer le rôle des robots dans le secteur de la santé, en particulier pour assister les soignants et améliorer la qualité des soins.
La méthodologie s’appuie sur une approche qualitative inspirée de la psychologie sociale, de la sociologie et de l’ergonomie du travail, fondée sur les théories de l’activité. L’étude portera non seulement sur les interactions directes robots-patients, robots-personnel et robots-visiteurs, mais aussi sur l’acceptation de ces robots évoluant au sein d’un groupe humain codifié dans un environnement sensible. Elle met au travail des questions fondamentales pour l’innovation, comme l’inclusion des expertises soignantes dans les solutions technologiques à l’hôpital, et l’ouverture de ces domaines de haute technologie à un plus large segment de la population.
Thèse soutenue le 26 novembre 2024 : L’individualisation des prises en charge du vieillissement dépendant. Une ethnographie du travail en maison de retraite médicalisée
sous la direction de Bruno Milly
À partir d’une enquête ethnographique dans trois maisons de retraite médicalisées, cette thèse examine les pratiques du personnel des maisons de repos à la lumière des normes d’individualisation du traitement des résidents. L’enquête s’intéresse tout d’abord aux évolutions politiques et normatives du travail médico-social en France, qui ont placé l’usager « au centre » de l’intervention sanitaire et sociale. Mettant ces éléments en perspective avec les enjeux contemporains de l’intervention sur le vieillissement dépendant, la thèse donne à voir la spécificité de l’individualisation des prises en charge des personnes âgées en maison de retraite.
La thèse analyse ensuite les principes organisationnels et pratiques des soins dans ces institutions. Aux prises avec une logique de rationalisation des ressources matérielles et temporelles, les aides-soignantes – qui ont été les principaux sujets de l’enquête – composent avec des prescriptions d’individualisation qui régissent la conduite de l’activité : la personnalisation « pluridisciplinaire » des soins et la « domesticisation » des espaces. La thèse montre que la « pluridisciplinarité » est à la fois très médicalisée et peu technique. À cet égard, les aides-soignantes apparaissent centrales dans les délibérations collectives, mais jouent un rôle subalterne dans la collecte d’informations au profit des professionnelles plus qualifiées. Ensuite, l’enjeu de faire de l’établissement un « lieu de vie » se heurte à l’organisation pratique des journées soignantes et résidentes. Ainsi, alors qu’elles doivent effectuer un travail de « domesticisation » des espaces de la maison de retraite, les aides-soignantes priorisent régulièrement la tenue des cadences et la répartition des tâches dans le collectif soignant sur les rythmes domestiques des résidents.
La thèse identifie enfin deux principes guidant les activités professionnelles : d’une part, celui de la préservation et du renouvellement de l’autonomie des personnes âgées, et d’autre part, celui de la socialité des résidents. La question de l’autonomie soulève les tensions qui traversent la personnalisation des soins : les professionnelles valorisent l’autodétermination des résidents en même temps qu’elles travaillent collectivement à faire correspondre leurs « volontés » aux exigences d’organisation et aux enjeux du travail de soin. En analysant l’idée émique que le soin est nécessairement relationnel, la recherche interroge ensuite la forte valorisation professionnelle et surtout soignante de la « relation » aux résidents. Cette valorisation prend appui sur la promotion du caractère social du sujet de prise en charge, et sur les prescriptions d’entretien des sociabilités résidentes. Elle s’accompagne de la diffusion d’une norme contraignante de sollicitude au sein des collectifs de travail. Ces principes d’autonomie et de socialité des résidents, qui guident fortement l’activité dans les maisons de retraite, fondent une « fiction de l’accompagnement » à travers laquelle les aides-soignantes affirment l’autonomie relationnelle de personnes âgées parfois très dépendantes dans leurs interactions avec elles. La thèse montre en outre que la personnalisation des soins repose principalement sur une référence au passé biographique des résidents, couplée à une recherche de maintien de l’autonomie résiduelle.
Enfin, en identifiant les effets de l’individualisation des prises en charge sur le travail en maison de retraite, la thèse montre que celle-ci entraîne des rapports personnalisés aux contenus du travail. Cela résonne avec la concentration de certaines critiques de l’organisation sur ses conséquences sur les clients, et sur la difficulté à assurer les tâches relationnelles.
Mots-clés : dépendance – personnes âges dépendantes – maison de retraite médicalisée – Ehpad – unité de soins de longue durée – sociologie du travail – sociologie des organisations
Enseignements
Sociologie des territoires, Université Lumière Lyon 2, L3 sciences sociales : 3 x 19,25h
Théories sociologiques, ULL2, L2 sociologie : 20h
Santé et vieillissement, ULL2, atelier de lecture, enquêtes et approches, M1 sciences sociales : 3 x 4h
Initiation à l’enquête : analyse d’un problème social, ULL2, L1 sociologie et science politique : 19,25h
Quoi de neuf en sociologie du travail, ULL2, M1 sociologie du travail et des organisations : 3 x 4h
Ateliers de lecture, ULL2, M2 cours d’emploi en sociologie du travail et des organisations : 3 x 12h
Méthodologie, ULL2, L1 sciences sociales : 4 x 21h
Méthodologie de recherche en sciences sociales, Lycée Honoré d’Urfé de Saint-Etienne, DE Conseiller en économie sociale et familiale : 2 x 27h
Enquêter à partir de sa pratique, DE Educateur spécialisé (ARFRIPS), DE Assistant de service social (Rockfeller), convention avec l’ULL2 : 2 x 35h
Recherche collective, ULL2, M1 études sur le genre : 9,5h
Atelier d’écriture : écrire son mémoire, ULL2, M2 sciences sociales : 2 x 8h
Atelier et retour d’expérience d’écriture du mémoire, M2 cours d’emploi sociologie (SDO) : 3h
Autres
Membre de la rédaction en chef de Lectures
2022-2023 Assitante d’édition - Lectures
2019-2022 Chargée de rédaction pour la revue Lectures - Liens Socio
Publications
Thèses
- Thèse HAL Julia Chryssomalis, L’individualisation des prises en charge du vieillissement dépendant. Une ethnographie du travail en maison de retraite médicalisée, thèse soutenue le 26 novembre 2024
Communications
- Communication HAL Julia Chryssomalis, « Le travail relationnel des aides-soignantes en maison de retraite médicalisée : prescriptions organisationnelles et normes professionnelles », Le travail du care, Saint-Étienne, juin 2024
- Communication HAL Julia Chryssomalis, Fanny Westeel, « Poursuites de l’autonomie. Des conceptions sociale et médico-sociale du sujet à deux âges de la vie », séminaire de l’équipe Travail, Institutions, Professions, Organisations, Lyon, mai 2024
- Communication HAL Julia Chryssomalis, « La singularisation des personnes âgées dépendantes aux prises avec l’organisation du travail en maison de retraite médicalisée », Les conférences impromptues, Bourg-en-Bresse, avril 2024
- Communication HAL Julia Chryssomalis, « L’adaptation aide-soignante aux rythmes résidents en maison de retraite : une activité aux prises avec la circulation des temporalités », 10e congrès de l'Association française de sociologie, Lyon, juillet 2023
- Communication HAL Julia Chryssomalis, « Une technicité sensible ? La construction de savoirs et savoir-faire sensoriels des aides-soignantes en maison de retraite médicalisée », 10e congrès de l'Association française de sociologie, Lyon, juillet 2023
- Communication HAL Julia Chryssomalis, « « Se faire petite » pour ethnographier des pratiques de care. Les dimensions corporelles du travail d’enquête », JE "S’engager, gager, se dégager : les ficelles de l’ethnographe à l’épreuve de son terrain", Nantes, octobre 2022
- Communication HAL Julia Chryssomalis, « Le corps à l’épreuve de l’ethnographie : corps conformé, corps engagé, corps étiqueté », JE jeunes chercheurs "Le corps et l’épreuve de la thèse", Besançon, octobre 2022
- Communication HAL Julia Chryssomalis, « La contrainte hygiénique en maison de retraite médicalisée. Des conditions de travail à l’ethos professionnel aide-soignant », Premières doctoriales du Pôle Travail de l'Université Lumière Lyon 2, Lyon, octobre 2022
Articles
- Article HAL Julia Chryssomalis, Compte rendu de lecture "Chloé Gaboriaux, Camille Noûs (dir.), « Le travail et ses maux », Mots, n° 126, 2021, Lectures, novembre 2021 [voir]
- Article HAL Julia Chryssomalis, Compte rendu de lecture "Hervé Marchal et Jean-Marc Stébé, Introduction à la sociologie urbaine, Armand Colin, 2019, Lectures, octobre 2019
- Article HAL Julia Chryssomalis, Compte rendu de lecture "Nadège Vezinat, Vers une médecine collaborative. Politique des maisons de santé pluri-professionnelles en France, Paris, PUF, 2019, Lectures, juillet 2019